
Le livre de musique n’a cessé d’évoluer au fil des siècles, tant dans sa forme que par sa diffusion. De l’antiphonaire médiéval à la partition du XXe siècle, la Bibliothèque expose manuscrits et imprimés évocateurs de cette longue mutation.

Nature morte à la vielle (détail), par Henri-Roland de La Porte
huile sur toile, vers 1760
© Musée des Beaux-Arts-mairie de Bordeaux. Cliché L. Gauthier
***
Transcrire le son en signes lisibles et reproductibles est une préoccupation ancienne. Cependant, le terme de note désigne d’abord aux XIIe et XIIIe siècle la musique elle-même. Ce n’est qu’à la fin du XIVe siècle qu’il prend son sens actuel, sanctionnant un usage désormais répandu de ce signe musical.

Fragment d'antiphonaire noté (détail)
parchemin, XIIe siècle
La réforme carolingienne est à l’origine d’un intense foisonnement de mélodies utilisées au cours des cérémonies religieuses.
La notation neumatique, apparue au IXe siècle, permet de fixer et de transmettre ces monodies. Comme l’indique leur nom, issu du grec neûma (inclinaison), les neumes sont des signes appliqués à une syllabe, qui indiquent les inflexions vocales à exécuter. Ils prennent peu à peu un caractère plus complexe, avec le développement de neumes de deux, trois notes ou plus, et de neumes de conduction du mouvement mélodique.
L’antiphonaire est un recueil liturgique de tous les chants de l’office donnés par le chœur en réponse au célébrant. Ils sont identifiés par une lettre rouge : antienne (A), répons (R) ou verset (V). La notation est inscrite au-dessus du texte, sur quatre lignes tracées à la pointe sèche, celle du fa étant repassée en rouge ; en fin de ligne, un guidon précise à quelle hauteur commencera le premier neume de la ligne suivante.
Ce fragment comprend les pièces de chant de l’office pour la Septuagésime (9e dimanche avant Pâques) pour la Sexagésime et la Quinquagésime, et se clôt avec un hymne à saint Vincent. La présence de douze répons des matines témoigne d’une provenance monastique.

Antiphonaire (détail)
codex parchemin, début XVIe siècle
Au XVIe siècle, l’écriture musicale du plain-chant religieux est fixée, au terme d’une évolution amorcée quatre siècles plus tôt. Elle se présente sous forme de notes carrées sur une portée de 4 lignes indiquant la hauteur du son. Une clef indique la position du do (clef d’ut) ou du fa (clef de fa) au début de chaque portée.
Dans ce manuscrit figurent plusieurs exemples de neumes de diverse nature, attestant du degré de sophistication de ce type de notation, qui préfigure celle des partitions modernes :
punctum 
note isolée
podatus 
groupe de deux notes, celle du bas étant interprétée avant l'autre
clivis 
groupe de deux notes, celle du haut étant interprétée avant l’autre
porrectus 
neume formé de trois notes, celle du milieu étant plus grave que les deux autres
***

Airs mis en musique à quatre parties, par Pierre Cerveau, angevin
Paris, veuve R. Ballard et son fils, 1599
Impression en caractères mobiles du type petite musique en fer de lance
Ex-libris du pianiste Alfred Cortot (1877-1962)
Acquis en en vente publique en 1992
Ce chansonnier est représentatif de l’édition musicale française de la fin du XVIe siècle, dont le développement va de pair avec la diffusion des chansons polyphoniques profanes.
D’un très petit format oblong, il est de ce fait adapté aux besoins des chanteurs dont chacun tient sa propre partie, en l’occurrence celle de la voix la plus haute (superius), seule conservée. Imprimée sur deux pages en regard, écrite sur 4 portées de 5 lignes, chaque mélodie se lit d’un seul coup d’œil. Son début est facilement repérable grâce à une lettrine ornée, laissant en retrait la première portée.
Ce type de production fait la fortune de la famille parisienne Ballard. Fondé en 1551, son atelier règnera sans partage sur l’impression et l’édition musicale française jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Il s’agit ici d’un recueil d’airs composés par le musicien angevin Pierre Cerveau, dont il demeure le seul ouvrage connu. Dans son adresse à l’évêque d’Angers Charles Miron, l’auteur expose que « cette sorte de musique » peut être exécutée « soit avec les voix simplement sans instrumens soit avec les instrumens mariez avec la voix ». Contrairement à ce qu’indique le titre, le volume comprend également 7 airs à 5 parties. Les poèmes mis en musique sont notamment signés de Jean Bertaut ou Jean-Antoine de Baïf (Eau vive source d’amour).
La notoriété de Pierre Cerveau lui vaut une anagramme élogieuse de son nom : Vive ce pré rare, accompagné du quatrain suivant :
Vive toujours ce pré, délicieux et rare
Où l’esprit enchanté, parmi les fleurs s’égare
Lequel produist des fruictz, d’une telle excellance
Que l’odeur s’en répend, parmy toutte la France
***

Marque de l'imprimeur Christophe Ballard, 1685

Roland, tragédie mise en musique, par M. de Lully…,
À Paris, par Christophe Ballard, 1685
Rés. SA 3527
À l’époque de la publication de Roland, Christophe Ballard, « seul imprimeur du roi pour la musique », jouit encore d’un monopole de fait sur l’édition musicale, hégémonie qui résulte notamment d’une habile politique de transmission familiale de la charge et de l’atelier. D’un point de vue commercial, les Ballard ont produit de nombreuses collections, d’une durée moyenne de quinze ans, imprimées grâce à un matériel typographique acquis dès le XVIe siècle. Le revers de cette pérennité réside dans le défaut d’innovation et l’aspect progressivement démodé de leurs éditions.
En 1672, le compositeur Jean-Baptiste Lully obtient – situation inédite - un privilège général de trente ans pour l’impression de ses œuvres, avantage considérable qui s’impose à celui dont bénéficie Christophe Ballard. Ce dernier est désormais contraint d’en passer par les exigences du musicien, tant dans la négociation des contrats que pour la publication de partitions in-folio, dont l’apparition constitue une grande nouveauté.
Exclusivement réservées aux tragédies lyriques de Lully et à leur réédition, ces partitions permettent au chef d’orchestre de lire simultanément toutes les parties. Toutefois, si la forme en est neuve, l’impression demeure traditionnelle, avec des caractères mobiles en fer de lance.
La postérité de ces éditions reliées en veau, radicalement différentes des publications musicales antérieures, en fera au XVIIIe siècle des éléments indispensables de toute bibliothèque dont le propriétaire veut afficher son statut social. Mais si l’on en croit la Revue de Paris de 1834, la mode en est bien passée à cette date… : « […] les œuvres de Lulli encombrent nos bibliothèques, cette denrée abonde, et j’en ai donné la charge d’un âne à un dilettante qui a bien voulu m’en débarrasser » y écrit Louis-Désiré Véron.
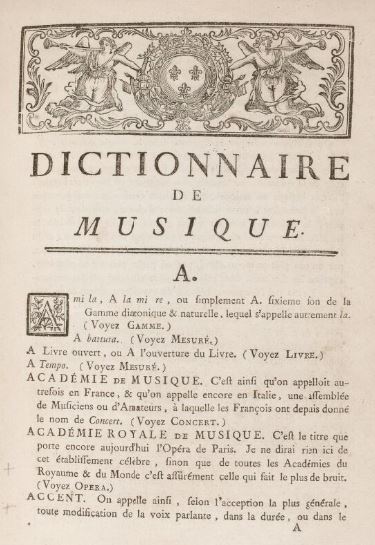
Dictionnaire de musique, par J.-J. Rousseau,
Paris, chez la veuve Duchesne, 1768
SA 3492
Jusqu’au XVIIIe siècle, la musique circule essentiellement grâce à la copie manuscrite, malgré les progrès de l’édition imprimée. Il existe ainsi des ateliers au sein desquels les copistes sont capables de fournir plusieurs manuscrits de la même œuvre, parfois à destination des imprimeurs.
Dans la notice « Copiste » de son Dictionnaire de musique, Jean-Jacques Rousseau insiste sur la supériorité de la copie manuscrite sur tout autre procédé de reproduction de la musique. Il la juge plus précise, plus souple, plus « commode », à condition d’être parfaitement exécutée.
Son texte décrit les connaissances techniques et qualités nécessaires pour y parvenir. Il est vrai que la profession de copiste ne lui était pas étrangère, pour l’avoir lui-même pratiquée : « mauvais copiste, j’expose ici ce que sont les bons ». Le rôle du copiste, intermédiaire entre le musicien et les auditeurs, est essentiel pour que « la musique exécutée rende exactement à l’oreille du compositeur ce qui s’est peint dans sa tête en la composant ».
Toutefois, lorsque Rousseau publie son Dictionnaire, les avantages de la copie manuscrite sont déjà remis en cause par la concurrence de la musique gravée, à laquelle on prête désormais les mérites jusqu’alors attribués à la copie.

Le Printems, ariette à voix seule et simphonie...
composée par M. Joubert, organiste de l'abbaye royale de Saint-Aubin d'Angers
De l'imprimerie de Richomme. Gravé par Mlle Vendôme et le sieur Moria, [1776]
La gravure en musique ne se développe en France qu’à partir de 1660, date de l’édit de Saint-Jean-de-Luz, qui dispense les graveurs de l’assujettissement à une communauté de métiers.
Elle répond au souhait croissant des musiciens de diffuser une reproduction fidèle de leurs œuvres, exempte des erreurs dues au manque d’application des copistes ; par ailleurs, la typographie musicale se révèle de son côté mal adaptée à la publication de manuscrits de plus en plus complexes.
La gravure rend possible la correction entre deux tirages, un ajustement à la fréquence des ventes par une multiplication aisée des copies, et nécessite un faible investissement en papier. Grâce à ces atouts, elle rivalise rapidement avec l’édition imprimée, alors qu’elle était envisagée à l’origine comme une simple amélioration de la copie. Techniquement, il s’agit de gravure en taille-douce sur des plaques de cuivre, pratiquée au moyen d’outils spécialisés, propres à rendre la variété croissante des signes de l’écriture musicale.
À la fin du XVIIIe siècle, les femmes – la première connue est Louise Roussel en 1723 - dominent cette discipline. Plus nombreuses que les hommes dans la profession, elles gravent environ 55 % de toutes les partitions.
Jouissant d’une grande réputation, Marie-Charlotte Vendôme, née vers 1732, se distingue à la fois par la longueur de sa carrière et l’excellence de son travail. Au sommet de sa réussite, elle s’associe avec le graveur et éditeur de musique François Moria. De leur collaboration sont issues de nombreuses partitions, telle cette ariette imprimée par Richomme, grand éditeur de musique de la fin du siècle, dont le fils devient l’apprenti de Mlle Vendôme en 1766.
L'auteur de cette pièce musicale, Denis Joubert (1746-1802) appartient à une famille de musiciens tourangeaux. Organiste de l'abbaye Saint-Aubin à partir de 1766, il quitte Angers pour Nantes en 1776. Sa composition est dédiée au baron Pierre Luthier de La Richerie, médecin et futur fondateur de la Société des botanophiles. Elle figure dans une annonce de vente des Affiches d'Angers du 10 mai 1776.

2e sonate pour piano de Jean Huré, dédiée au pianiste Yves Nat (1890-1956)
Manuscrit autographe, novembre 1916
Rés. Ms. 2206 (12)
L’intérêt pour la conservation et l’étude des manuscrits autographes de compositeurs n’est guère antérieur au début du XIXe siècle. Il est contemporain des premières publications de catalogues thématiques et éditions critiques des œuvres, dans lesquels l’autographe apparaît comme une source majeure. Lui seul permet en effet d’espérer retrouver la pensée originelle du musicien et de reconstituer son processus de création.
Ce changement de regard sur un document considéré jusque-là comme utilitaire, et presque dédaigné, traduit un nouveau souci de fidélité au texte et de respect du compositeur, qui trouve un premier aboutissement avec l’édition du Don Giovanni de Mozart en 1887.
La partition autographe de la 2e sonate pour piano de Jean Huré (1877-1930), avec ses ratures, ses annotations et ses collettes (pièce de papier collée sur le document afin d'y insérer une modification) donne à voir la genèse de l'oeuvre et révèle la personnalité de son auteur. La copie au propre est éditée en 1920. Ce manuscrit appartient au riche fonds d'archives du musicien donné à la Bibliothèque municipale en 1956 et 1963 par Marie-Louise Boëllmann-Gigout, exécutrice testamentaire de Jean Huré, et comme lui organiste.